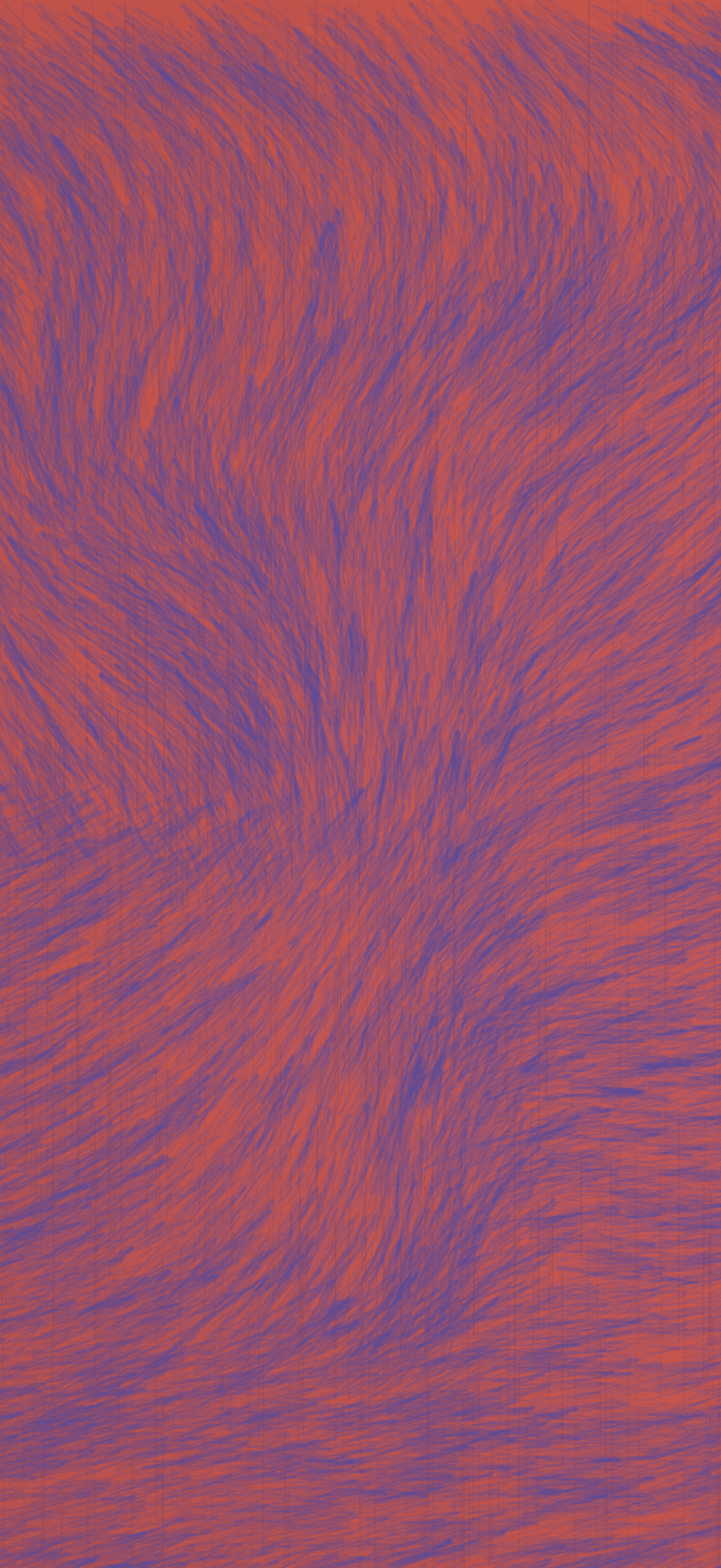
Séquencer, calibrer, combiner : la transition écologique suppose un art du comment
En matière climatique, nous connaissons désormais bien la destination : atteindre la neutralité carbone d’ici une trentaine d’années. Cette obligation de résultat, souvent énoncée avec désinvolture, implique pourtant des changements - économiques, culturels, sociétaux - majeurs. Plus de 80 % de l’énergie primaire consommée dans le monde est encore d’origine fossile. De même que Solow déclarait en 1987 que les ordinateurs étaient partout sauf dans les statistiques de la productivité, de même nous pourrions dire : l'écologie est partout, sauf dans les statistiques de la décarbonation. Nous sommes drogués aux énergies fossiles, et l'enjeu est celui d'une immense transformation, énergétique, industrielle et bien sûr sociétale.
En réalité, pour atteindre le résultat de la neutralité carbone, nous allons devoir conduire en même temps quatre types d’actions :
- faire évoluer les comportements individuels dans le sens d’une plus grande sobriété : prendre moins souvent l'avion et modifier ses pratiques de tourisme, adopter une alimentation moins riche en protéines animales, changer sa voiture thermique au profit d'un véhicule électrique si possible moins lourd pour les mobilités du quotidien… Derrière des « gestes » en apparence anodins, il y a en réalité des milliers de milliards d’euros de CAPEX à réaliser par les ménages et des changements d’habitudes très profonds. Pour autant, ces changements individuels ne permettront de résoudre que 15 à 30 % du problème.
- il faudra aussi transformer l’appareil de production, c'est-à-dire l'offre : l’industrie devra gagner en efficacité énergétique et se décarboner. Nous aurons toujours besoin de produire du papier, du carton, du ciment, du béton… mais aujourd'hui l'empreinte carbone des processus de production associés à ces matériaux, essentiels à notre civilisation "hyper-industrielle", est désastreuse. L’agriculture devra également engager sa transition protéique au moyen de lourds investissements de transformation des exploitations agricoles, qui ne pourront pas être supportés par la seule profession paysanne, comme l'actualité est venue nous le rappeler…
- l'innovation technologique jouera aussi un très grand rôle. Le coût de production des énergies renouvelables (éolien et solaire) a drastiquement chuté ces dernières années, et la densité massique des batteries électriques s’est améliorée. Nous le devons largement à l’immense effort industriel accompli par la Chine depuis la fin des années 2000. Il est d'ailleurs temps que l’Europe investisse dans une politique industrielle et technologique verte digne de ce nom si elle ne veut pas se déclasser sur le plan productif. L'essentiel de l'innovation technologique ne réside d'ailleurs pas dans des "inventions" comme l'avion à hydrogène ou certains procédés de captage et de stockage du carbone, mais dans le fait de faire baisser au maximum les coûts de production et d'acquisition des infrastructures de production, de transport, de stockage et de distribution d'électricité décarbonée. Il y a d'autres territoires de conquête technologique, comme la géothermie pour le chauffage collectif ou les nouvelles technologies de sélection variétale dans l’agriculture…
- enfin l’innovation sociale, qu’on oublie trop souvent. Rendre nos villes moins énergivores suppose un nouvel imaginaire urbain, fondé sur la densité, l'intensification des usages des bâtiments, la verticalité aussi. Il faut rapprocher domicile, lieu de travail et lieu de récréation, à rebours des approches segmentaires du XXe siècle. Ces évolutions culturelles sont les plus complexes à conduire car elles mélangent en réalité les trois premières familles d'action : c'est un composé de changements d'habitudes (vivre plus près de son lieu de travail ou télétravailler, se déplacer davantage à pied ou à vélo), de modification de l'offre de transports (les RER métropolitains par exemple) et bien sûr d'innovations technologiques (la data jouera un très grand rôle dans l'avènement de cette ville bas-carbone).
On l’aura compris, il n’y a pas de solution miracle pour réussir cette transformation totale. À cet égard il est un peu désolant que le débat sur la transition soit encore polarisé par des postures morales (apologie de la sobriété heureuse) ou idéologiques (apologie de la décroissance), alors que la réussite de cette transformation suppose de dessiner un chemin d'action beaucoup plus précis.
Les deux questions essentielles à se poser sont les suivantes :
- comment doser les quatre familles d’action identifiées ci-dessus, globalement et dans chaque système socio-technique (la ville, l'industrie, l'agriculture, les transports...) ? Car, nous l'avons vu, il n'y a pas de solution miracle, aucune famille d'action ne suffira seule à résoudre le problème. Question d'autant plus redoutable qu'en matière climatique, « le voyage compte plus que la destination » : il y a plusieurs façons d’atteindre la neutralité carbone. Dans certains secteurs comme l’industrie l’essentiel se jouera du côté de la transformation de l'offre et de l’innovation technologique. Dans d’autres, comme les systèmes urbains, les changements d’habitudes et l’organisation sociale joueront un plus grand rôle que l'innovation. Dans l'agriculture, il faudra un cocktail assez équilibré entre changements d'habitudes alimentaires, transformation de l'appareil de production, innovations technologiques et évolution du "contrat" passé entre la société et ses agriculteurs. Les quatre scénarios de l’ADEME vers la neutralité carbone avaient le grand mérite de nous montrer qu’il existe plusieurs chemins « éco-socio-techniques » pour arriver à la même destination. Hélas, ils n'ont fait l'objet d'aucun débat public d'ampleur. Ce qui est valable pour la société tout entière est valable pour chaque grand système socio-technique. Si l’agro-écologie est la destination évidente sur laquelle nous devrions tous être d'accord, il y a plusieurs façons de transformer l’agriculture pour arriver vers ce but, avec plus ou moins de technologie, plus ou moins de relocalisation, plus ou moins de végétalisation de la production, plus ou moins d’intervention publique ou bien de marché par exemple pour rémunérer les services environnementaux… Où et quand discute-t-on sérieusement de ces chemins ?
- Une fois identifié le chemin éco-socio-technique, il faut chiffrer le coût des changements et notamment des investissements. La seconde question essentielle est donc : Qui doit payer pour quoi ? Dans quel ordre ? Avec quelles ressources ? Le débat sur le financement colossal de la transition écologique est intéressant, il progresse un peu depuis le rapport Pisani-Mahfouz, mais il reste très « macroéconomique ». On parle de milliers de milliards d’euros, de dette publique, d'impôts, de création monétaire, mais ces ordres de grandeur et ces concepts sont encore trop abstraits. Il est temps d’entrer dans le grain fin, secteur par secteur et de développer des ingénieries financières innovantes ainsi que des "contrats de transition" justes répartissant le plus équitablement possible les efforts entre les différents acteurs, groupes sociaux, territoires et générations.
On l’aura compris, l’urgence climatique fait que le chemin compte plus que la destination. Si nous avons une obligation de résultat, désormais bien connue et acceptée, les réflexions restent très pauvres en matière de moyens, de modalités concrètes, de chemins à emprunter. C’est à éclaircir ce comment que nous devrions désormais employer toute notre énergie. C'est ce à quoi nous avons tenté de contribuer avec Xavier Desjardins, en écrivant "La Révolution obligée" (Allary éditions).